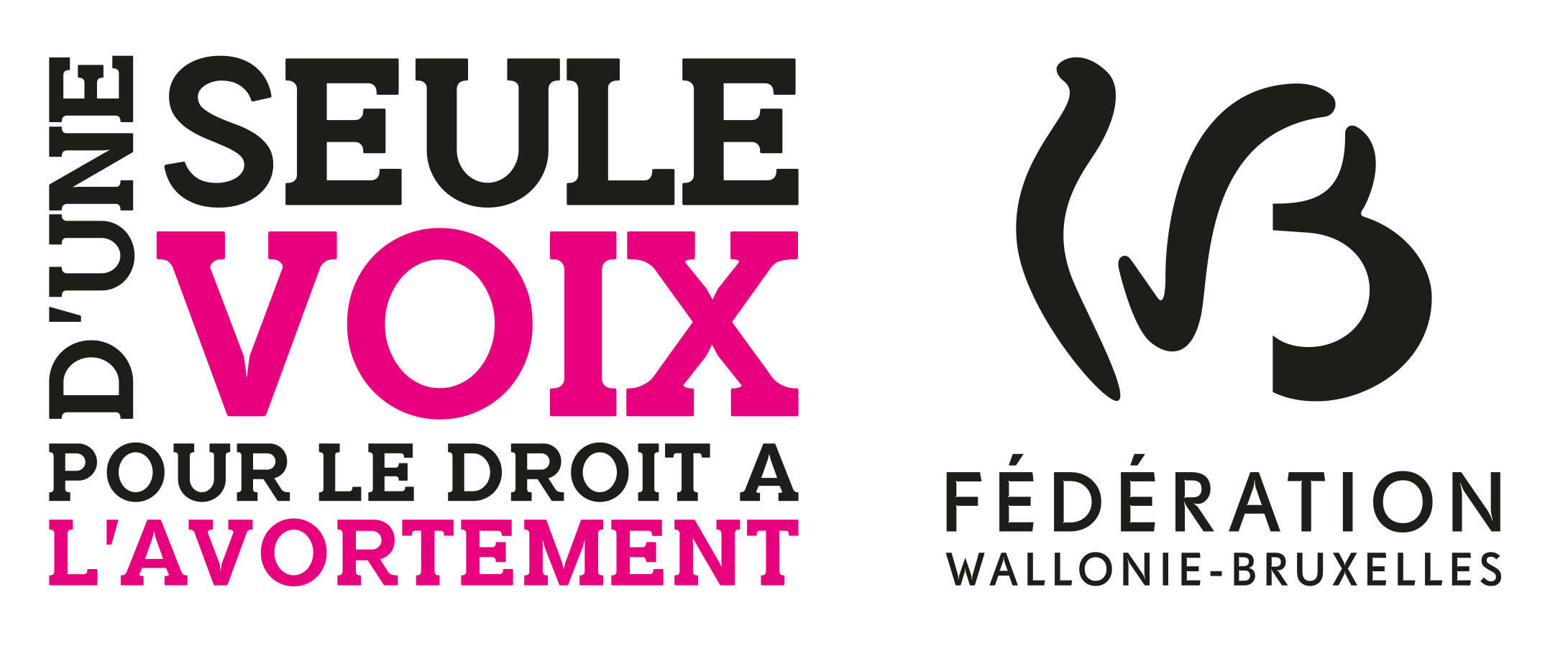-
Existe-t-il des risques de complications médicales lors d’une interruption volontaire de grossesse encadrée ?
NON, les complications médicales suite à une interruption volontaire de grossesse (IVG) sont très rares lorsque celle-ci est pratiquée par un prestataire de soins de santé qualifié, dans des conditions sanitaires sécurisées suivant une méthode appropriée à la durée de la grossesse, comme préconisé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Quels sont les risques de complications médicales lors d’une interruption de grossesse hors assistance médicale ?
Environ 50.000 femmes en meurent chaque année et 7 millions en subissent les séquelles. L’OMS recense annuellement 25 millions d’interruptions volontaires de grossesse sans encadrement médical minimal par des personnes qui n’ont pas les compétences nécessaires, dont 8 millions pratiquées dans les pires conditions, dangereuses et invasives. Raison pour laquelle l’OMS a publié des directives techniques et stratégiques à l’attention des systèmes de santé des États dans le monde. La ortalité due aux IVG à risque pèse de manière disproportionnée sur les femmes en Afrique. Les principales complications sont : hémorragie, infection et lésions du tractus génital et des organes internes.
-
Limiter ou interdire l’accès à l’IVG en restreint le nombre ?
NON. Le manque d’accès légal à l’IVG conduit les femmes à recourir à des avortements clandestins par des moyens non médicalisés et dans des conditions non hygiéniques qui les exposent à des risques importants de blessures et de décès. De fait, presque tous les décès résultant d’IVG pratiquées dans des conditions dangereuses se produisent dans des pays où l’avortement est interdit ou restreint. Le constat est fait par l’OMS : la levée des restrictions liées à l’IVG réduit la mortalité maternelle. En pratique, les décès et séquelles graves consécutifs à des IVG non sécurisées pourraient être évités par un accès légal à l’IVG, avec des soins prodigués rapidement en cas de complications, dans un contexte qui permet une éducation sexuelle comprenant l’utilisation de moyens de contraception efficaces.
-
L’éducation à la vie sexuelle, relationnelle et affective a-t-elle un impact positif sur les droits sexuels et reproductifs des jeunes ?
OUI. L’éducation sexuelle dispensée dans les écoles à un effet positif et durable sur la santé et le bien-être des jeunes filles et des garçons. À l’échelle européenne, les études démontrent que l’introduction de programmes nationaux d’éducation sexuelle à long terme entraine chez les jeunes de 15 à 24 ans une réduction des grossesses et des IVG ainsi qu’une baisse des taux d’infections sexuellement transmissibles (IST) et d’infections par le VIH. En augmentant la confiance et en renforçant les compétences de chacun.e, l’éducation à la sexualité donne aux jeunes les moyens de poser des choix éclairés et de s’épanouir dans leur vie sexuelle et affective.
-
Peut-on parler d’un DROIT à l’interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes ?
OUI. Organe des Nations unies, l’OMS définit pour tous les couples et les individus des droits sexuels et reproductifs qui leur permettent de pouvoir librement et avec discernement décider du nombre d’enfants qu’ils souhaitent ou pas, ainsi que celui de prévoir l’espacement de leur naissance. Cela suppose que tout individu puisse prendre des décisions en matière de procréation sans être soumis à une discrimination, coercition ou violence relationnelle ou sociétale. L’avortement et la planification familiale font donc partie, selon l’OMS, des droits sexuels et reproductifs, dans le cadre plus large du droit à la santé.
Concernant l’interruption volontaire de grossesse proprement dite, depuis les années 1990, de nombreuses recommandations des comités des droits de l’homme et des agences de l’ONU ainsi que d’organes régionaux et européens enjoignent les États à légiférer et à garantir un accès pour toutes les femmes à des IVG sécurisées sur le plan médical, réalisées dans des délais de gestation raisonnables, et ce sans sanctions pénales ni restriction. Les rapports de ces comités et organes condamnent, à intervalles réguliers, certains États réfractaires à leurs recommandations. Cependant, il n’existe pas de mécanisme contraignant supranational mandaté pour les contraindre à modifier leur législation ou pour infliger des astreintes en cas de non-respect de ces recommandations.
Au niveau des 28 États membres de l’Union européenne, ni la Convention européenne des droits de l’homme ni les directives et règlements européens n’établissent, en tant que tels, un droit à l’IVG mobilisable devant un organe juridictionnel européen comme la Cour de Justice ou la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, la sexualité et la reproduction sont régies par le principe de subsidiarité et relèvent donc de la compétence des 28 États membres. Cependant, le droit aux soins de santé est consacré dans le droit européen, notamment à travers la charte des droits fondamentaux. De plus, la protection et l’amélioration de la santé sont du ressort de l’UE, en complément de l’action des États membres. Enfin, dans le nouveau consensus européen sur le développement, les États membres se sont prononcés pour la protection et la promotion des droits sexuels et reproductifs des femmes, en ce compris l’accès à des services de planification familiale et d’éducation sexuelle, notamment afin de lutter contre la mortalité maternelle dans le monde.
En conclusion, tant au niveau international qu’européen, les États ont le devoir de veiller à ce que les femmes puissent prendre des décisions concernant leur vie sexuelle et reproductive, sans crainte de discriminations, de mesures coercitives ou d’actes de violence. Pour ce faire, outre un large éventail d’informations, les États doivent garantir aux femmes un accès aux services de santé pour éviter tout risque de souffrances, de mort ou de poursuites pénales quelconques. Ces dernières années, les multiples prises de position du Parlement européen en la matière ainsi que les recommandations du Conseil de l’Europe pourraient influencer l’Union européenne dans la voie d’instaurer un véritable droit à l’IVG inclus le droit communautaire.
-
La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît-elle un droit à l’avortement dans sa jurisprudence ?
OUI et NON. Malgré le fait que pour la Cour, l’avortement peut mettre en concurrence les intérêts de la femme et les intérêts du fœtus, et malgré le fait que la Cour se focalise dans ses arrêts davantage sur les raisons pour lesquelles les femmes souhaitent avorter que sur les difficultés concrètes auxquelles celles-ci sont confrontées, le droit à l’avortement trouve cependant une certaine forme de reconnaissance dans la jurisprudence au travers de l’interprétation que la Cour fait des articles 3 – Interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou et dégradants- et 8 –Droit au respect de la vie privée et familiale– de la Convention.
En effet, lorsque l’état de la femme enceinte s’accompagne de circonstances exceptionnelles comme un danger pour sa santé ou une maladie incurable du fœtus, l’impossibilité pour elle d’avorter peut être assimilée à un traitement inhumain et dégradant ou à une violation de sa vie privée.
Dans trois arrêts – Affaire Tysiac contre Pologne du 20 mars 2007, affaire AB et C contre Irlande du 16 décembre 2010 et affaire R.R contre Pologne du 28 novembre 2011 – qui concernaient des femmes souhaitant avorter en Pologne et en Irlande en raison d’une grossesse qui aggravait sérieusement leur état de santé ou celui de leur fœtus, la Cour a indiqué que dès lors que l’avortement était reconnu par ces États, même de manière très restrictive, ceux-ci avaient l’obligation de ne pas limiter l’accès effectif à une telle intervention.
Dans les trois cas, la Cour a estimé qu’il fallait aborder la situation des femmes sous l’angle des obligations positives de l’État qui supposent une procédure effective et accessible permettant aux femmes de savoir si elles ont la possibilité de recourir à une interruption de cette grossesse gravement problématique. En l’espèce, la Cour a donné raison aux femmes plaignantes et condamné les États défaillants.
-
Existe-t-il un droit à la vie « dès la conception »?
NON. L’historique des négociations entourant l’article 3 relatif au « droit à la vie » consacré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme suppose explicitement que les droits fondamentaux commencent à la naissance et protègent des personnes et individus. De même, d’autres traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, tels qu’ils ont été rédigés et/ou interprétés par la suite, rejettent clairement l’idée de droits humains garantis depuis la conception ou avant la naissance. Cette position apparaît de manière très claire dans les travaux en cours du Comité des Droits de l’homme des Nations Unies sur l’interprétation du « droit à la vie » tel que protégé dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces instruments internationaux et régionaux reconnaissent aussi que le droit des femmes à la vie et d’autres droits fondamentaux (droit à la vie privée, droit à la santé, droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination) sont en jeu quand des lois restrictives sur l’avortement sont en vigueur.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, rien dans la Convention ne s’oppose à ce qu’un Etat permette aux femmes d’avorter, pas même le droit à la vie garanti à l’article 2 de celle-ci. La Cour n’établit donc pas que cet article puisse bénéficier directement au fœtus. Elle indique à ce propos, dans l’affaire VO contre France du 8 juillet 2004, que « dans les circonstances examinées par les organes de la Convention à ce jour, à savoir les législations régissant l’avortement, l’enfant à naître n’est pas considéré comme une personne directement bénéficiaire de l’article 2 de la convention et que son droit à la vie, s’il existe, se trouve implicitement limité par les droits et intérêts de sa mère ».
-
Un médecin peut-il refuser de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ?
OUI et NON. Il faut distinguer l’objection de conscience, reconnue dans l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme uniquement dans le cadre du service dans les forces armées et ce que l’on dénomme « clause de conscience ». Cette appellation est utilisée pour les soins de santé, mais ne constitue aucunement un droit, qui n’est en conséquence garanti par aucun texte contraignant.
Ni la Cour européenne des droits de l’homme ni le Comité européen des droits sociaux n’ont consacré de droit à une clause de conscience dans le cadre des soins de santé ; dans deux affaires dans lesquelles les requérants alléguaient une violation de ce droit (affaire Pichon et Sajous contre France du 2 octobre 2001 et affaire fédération des associations familiales catholiques et Europe contre Suède du 17 mars 2015), la Cour et le Comité ont considéré que le refus de pratiquer pour clause de conscience n’était pas garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
Si le recours à une « clause de conscience » dans le cadre des soins de santé n’est pas reconnu dans l’ordre juridique du Conseil de l’Europe, les juridictions internationales ont considéré que les États membres pouvaient reconnaître un tel droit à leur personnel de santé. La Cour et le Comité n’ont jusqu’ici pas remis en cause les législations nationales comprenant un tel droit de refus dans le chef des praticiens.
En revanche, les conséquences de l’utilisation d’une clause de conscience entravant le droit des patients ont été soumises à jugement, tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par le Comité européen des droits sociaux ; ces deux instances ont jugé que l’exercice d’un recours à la clause de conscience par les médecins pouvait entrainer une violation des droits des patients à la vie privée et à la santé. Ainsi les États, s’ils consacrent un tel droit à une clause de conscience, ont l’obligation de l’encadrer de telle sorte qu’il ne vienne pas heurter les bases d’un système de santé dont le but premier n’est pas d’assurer aux médecins le plein exercice de leur droit à la liberté de conscience, mais bien de soigner les patients.
Dans l’affaire Tysiac contre Pologne du 20 mars 2007, la Cour a estimé qu’« une fois que l’Etat a fait usage de la marge d’appréciation mentionnée ci-dessus pour adopter une législation autorisant l’avortement, il ne doit pas concevoir le cadre juridique correspondant d’une manière qui limite dans la réalité la possibilité d’obtenir une telle intervention. En particulier, l’État a l’obligation positive d’instaurer un cadre procédural permettant aux femmes enceintes d’exercer leur droit d’accès à un avortement légal ». Enfin, il est utile de rappeler que la clause de conscience lorsqu’elle est organisée par la législation d’un État reste un droit individuel dont seul le praticien concerné peut se prévaloir. En aucun cas, cette clause ne pourrait être institutionnalisée. Autrement dit, aucun centre hospitalier ne peut interdire le recours à l’avortement en invoquant une clause de conscience, celle-ci étant du ressort d’une décision individuelle invoquée par un praticien.